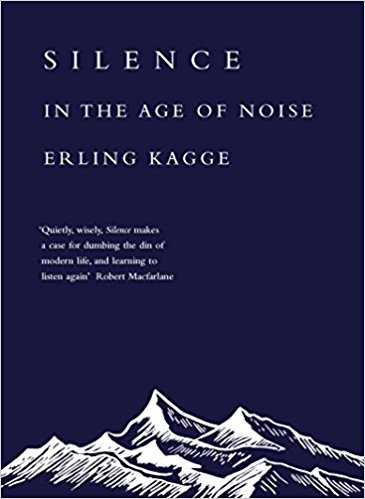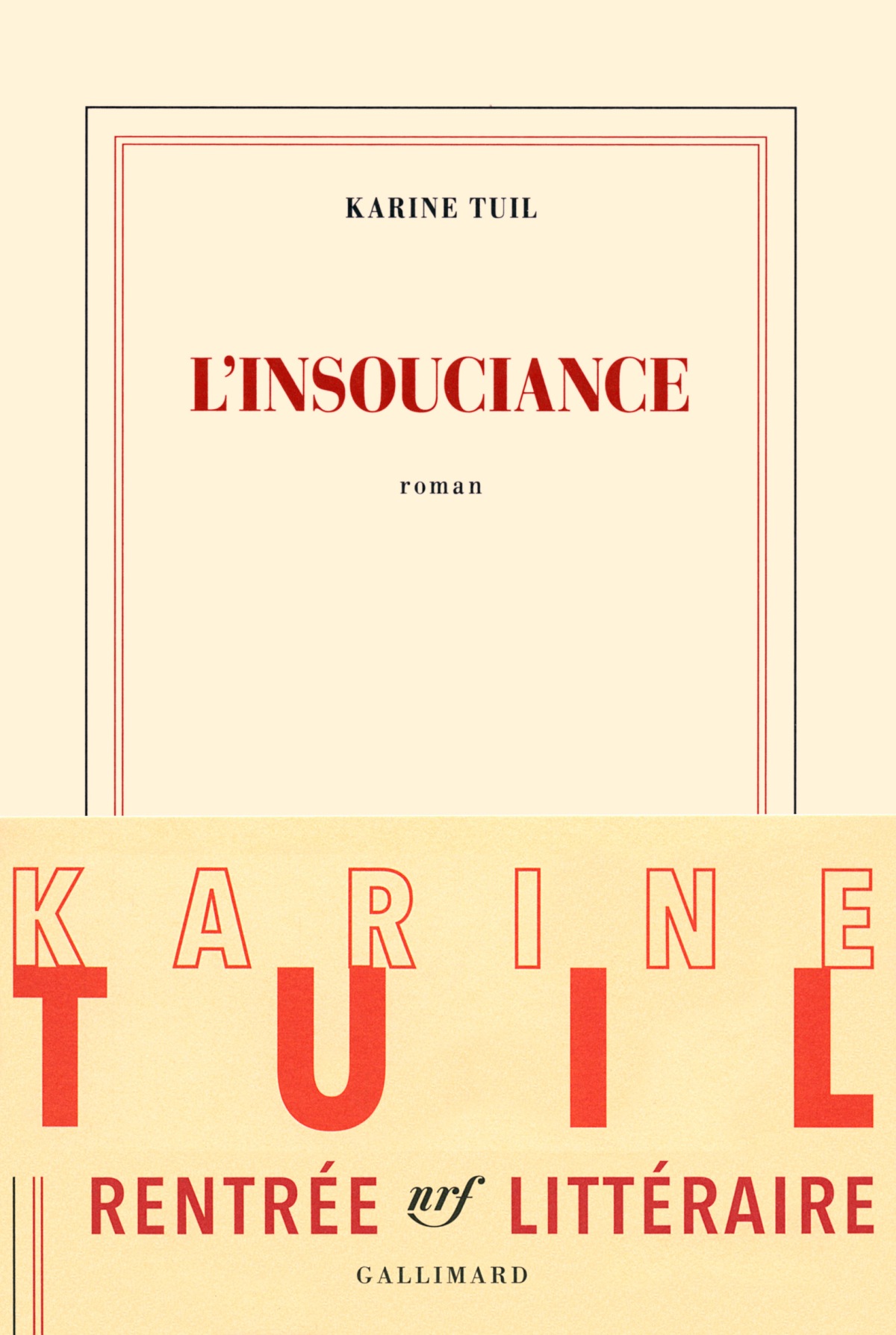« Aimez-vous lire? », sujet de rédac’ proposé par ma prof de français de 4e avant les vacances de la Toussaint. Je devais avoir quoi, 13 ou 14 ans et je n’aimais pas lire. Mais c’était aussi l’époque où tout le monde s’en foutait, on parlait de tout sauf de littérature dans la cour de récré, donc c’était pas grave. Et puis je n’étais pas « populaire » alors que j’aime lire ou non, ça n’allait pas changer la face du monde prépubère.
Quand je suis rentrée chez moi, après le collège ce jour-là, j’ai demandé à ma mère si je pouvais répondre franchement à la question qui m’était posée.
Etait-il acceptable de construire ma rédaction de français (qui allait être notée, on est en France les gars) sur un postulat anticlérical?
Etant donné que je ne me souviens plus de ce que ma mère m’a répondu, je vais énoncer les deux seules réponses qu’elle peut vraisemblablement m’avoir données : 1) oui (« il faut être honnête dans la vie » même si ça plombe ta moyenne générale) 2) Non (« La réponse est dans la question, enfin » levée d’yeux au ciel – si vous lisez ce post à voix haute précisez bien que je n’ai pas écrit « levez Dieu au ciel »).
Toujours est-il que j’ai hésité tout le long des vacances (comme je ne lisais pas, j’avais pas mal de temps pour me prendre la tête avec ce genre de trucs).
Devais-je avouer que je n’aimais pas lire ou devais-je mentir? Dans les deux cas je pouvais pondre le texte de l’année mais la deuxième solution était plus sûre, moins risquée. Je ne savais pas si répondre non à la question « aimez-vous lire? » vous enlevait d’office des points. J’avais peur de tomber dans un piège. Et comme je réfléchissais beaucoup à la question, j’ai fini par devenir complètement paranoïaque et par me dire, donc, que « si ça se trouve, elle me la fait à l’envers et elle me donnera une note encore meilleure si j’arrive à étayer mon raisonnement » comprendre: à expliquer qu’on pouvait ne pas aimer lire sans pour autant être un déchet.
Parce que quelques semaines plus tôt, on avait dû lire Dora Bruder de Patrick Modiano. J’avais beaucoup aimé (spoiler : je vais expliquer après pourquoi je pensais « ne pas aimer lire » alors qu’en fait j’adorais ça) mais un garçon de ma classe (un mec « pas populaire ») avait dit qu’il avait détesté parce qu’il n’y avait pas d’histoire. Bon, aujourd’hui je peux expliquer que c’était juste une erreur de vocable, que ce qu’il voulait dire par là c’était qu’il n’y avait pas d’ « action » mais sur le coup j’ai été interpellée parce que j’étais un peu d’accord. Et puis une fille de ma classe qui était comédienne (ce qui lui attirait un certain respect) avait explosé : « si tu cherches des histoires, tu n’as qu’à lire J’aime lire« . Sur le coup j’ai pris l’attaque pour moi. Je me suis dit que, mince, en fait si on cherchait de l’action dans les livres c’est qu’on était un enfant, qu’on était retardé quoi.
Tout ça pour expliquer pourquoi j’ai tant hésité à expliquer pourquoi je n’aimais pas lire. Et surtout pourquoi je pensais ne pas aimer lire. Parce que moi je cherchais bien des histoires dans ce que je lisais, j’aimais bien qu’il y ait un peu d’action même.
J’ai finalement écrit que je n’aimais pas lire parce que j’avais l’impression que ça me coupait du monde. Et je ne savais pas, en l’écrivant, que c’était la raison précise pour laquelle j’allais adorer ça. Le premier symptôme de la bibliophilie.
Car j’ai souvent constaté que les gens qui n’aiment pas vraiment la lecture ont du mal à rentrer dans un livre, à intégrer un récit à leur corps défendant. Certains lisent sans aimer ça, se forcent un peu parce qu’il est culturellement admis que « lire c’est chic » ou parce qu’ils n’ont rien d’autre à faire à un moment de leur vie.
Je vais prendre là l’exemple de mon frère qui s’est mis à lire vraiment cet été, dévorant plus de polars en un mois qu’il n’avait lu de livres en 25 ans. Il disait toujours « je ne suis pas un lecteur », il disait que le seul livre qu’il avait lu c’était Harry Potter. Il oubliait juste de préciser qu’il avait lu toute la série en français puis en anglais au moins trois fois. Mais il était admis qu’il n’était « pas un lecteur » puisqu’il n’avait lu « que » ça et ne passait pas sa vie avec un livre dans les mains. (Denis Podalydès, qui claironne qu’il ne lâche jamais ses livres, qu’il lit même en arpentant les couloirs du métro (impossible, j’ai testé et vous finissez toujours par rentrer dans quelqu’un ou dévaler un escalier sur les fesses) ou en achetant sa baguette, a fait beaucoup de mal à la littérature et aux lecteurs.)
On dit que c’est l’occasion qui fait le larron. Appliqué à la littérature ça donnerait : c’est le livre qui fait le lecteur. L’inverse est vrai aussi (cf. Ecole de la réception).
Quand il m’a fallu écrire cette rédaction, donc, j’ai expliqué pourquoi je ne voulais pas me couper de la vie. Je passais mes vacances chez ma grand-mère que j’adorais et je voulais savourer chaque seconde passée en sa compagnie. Ma grand-mère était elle-même une grande lectrice et je n’avais pas idée à l’époque que la lecture pourrait nous rapprocher encore un peu plus.
J’ai eu une des meilleures notes pour ce texte que j’ai écrit et que je n’ai pas gardé. Je regrette de ne pas pouvoir le relire aujourd’hui pour étayer un peu plus ma réflexion. Je suis sûre qu’il devait y avoir d’autres idées intéressantes sur la lecture et la possibilité ou non, pour l’adolescente que j’étais, de la concilier avec « la vie ».
Je vais finir avec la liste non exhaustive des livres que ma professeure m’a conseillé de lire après avoir lu ma rédaction (ce sont ceux dont je me souviens) et qui ont véritablement libéré la lectrice qui sommeillait en moi :
La Promesse de l’aube, Romain Gary
Le Père Goriot, Balzac
Manon Lescaut, Abbé Prevost
La Princesse de Clèves, Mme de Lafayette
La chambre des officiers, Marc Dugain
Un long dimanche de fiançailles, Sébastien Japrisot
Depuis cette courte liste, j’ai été transportée par de nombreux autres livres (romans, essais, biographies… je suis ouverte à toutes propositions littéraires) et si j’ai été insensible à certains, seule une dizaine de titres (en 15 ans c’est bien peu) m’a choquée par sa médiocrité ou sa mauvaise facture.
Le dernier livre qui m’a emportée et que je conseillerais aux lecteurs de plus de vingt ans (il n’y est pas question de pornographie, c’est juste qu’il me semble difficile à comprendre vraiment avant) est Bright Lights, Big City de Jay McInerney (qui est devenu un classique). Je l’ai lu en poche et en français parce que c’était la version que j’avais à ma disposition quand j’ai terminé LaLégende de Bruno et Adèle de Amir Gutfreund. J’avais envie d’un roman court et américain pour changer un peu d’air.


ATTENTION ! Ne cherchez pas de résumé sur Internet, ça ne donne jamais envie, à se demander qui les écrit (les maisons d’édition concurrentes? – Non non, je n’adhère pas aux théories complotistes).
Les américains n’écrivent pas comme les autres, ils ont une énergie particulière dans la plume, ils parviennent à traduire une tension que les français échouent souvent à mettre par écrit (ou que nous échouons, nous lecteurs, à débusquer).
La langue y est pour quelque chose, le rythme même donne autre chose que ce à quoi nous sommes habitués.
Et c’est chez des auteurs comme Bret Easton Ellis et Jay McInerney, que cette nervosité se fait le plus palpable. Bright Lights, Big City agit comme un reportage : on suit un héros (qui n’a pas de nom) l’espace de quelques jours seulement. Il est correcteur-vérificateur au New Yorker, s’est fait larguer du jour au lendemain par son mannequin d’épouse, et souffre en somme de frustration aiguë. Il ne se sent pas à sa place, sous-employé par des supérieurs hiérarchiques médiocres et de mauvaise foi qui ne cherchent qu’à le coincer pour pouvoir le virer. Il aimerait écrire mais s’est vite découragé. Alors il fait la fête avec un ami, prend trop de drogue, boit trop…
Ce qui fonctionne, au-delà du rythme, c’est qu’on rentre dans sa peau. Et c’est probablement finalement à ça qu’on reconnaît un personnage et un texte réussis. Parce que quand on devient le personnage, on a bien du mal à le condamner. On a surtout du mal à le soupçonner et c’est ce qui fait la force et la violence des thrillers réussis qui nous exaltent. On en voudra un peu à l’auteur de nous avoir leurrés mais s’il est réussi, le twist final nous laissera cois et nous permettra de dire à nos amis « Achète-le, tu vas adorer ».
To be continued…