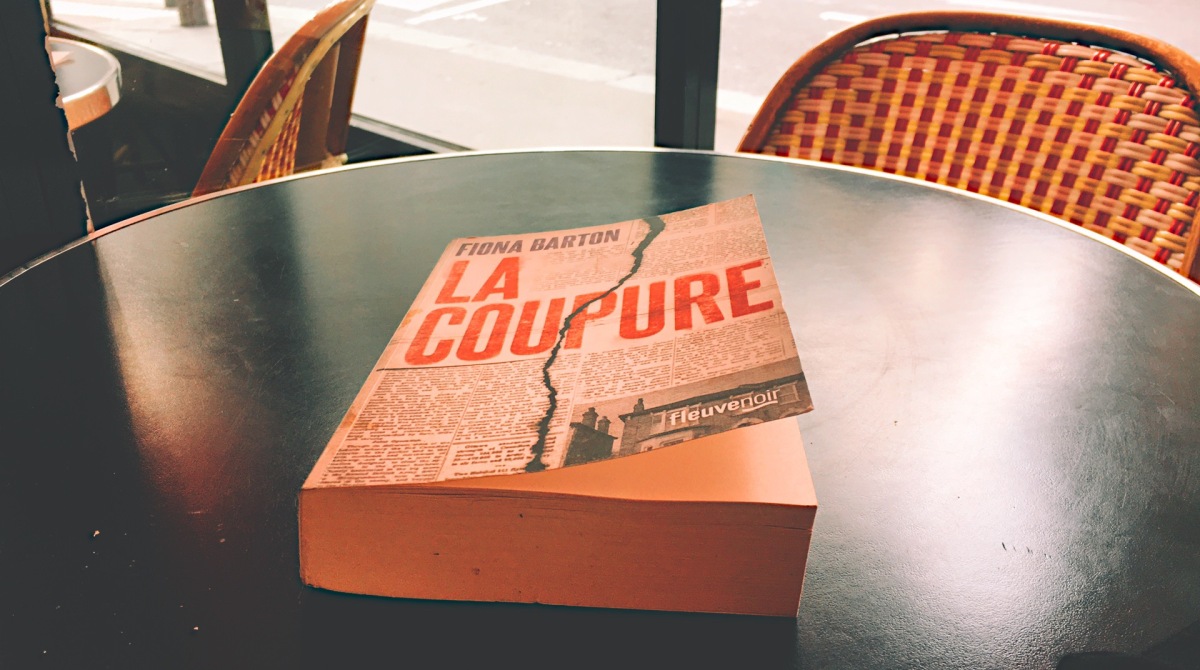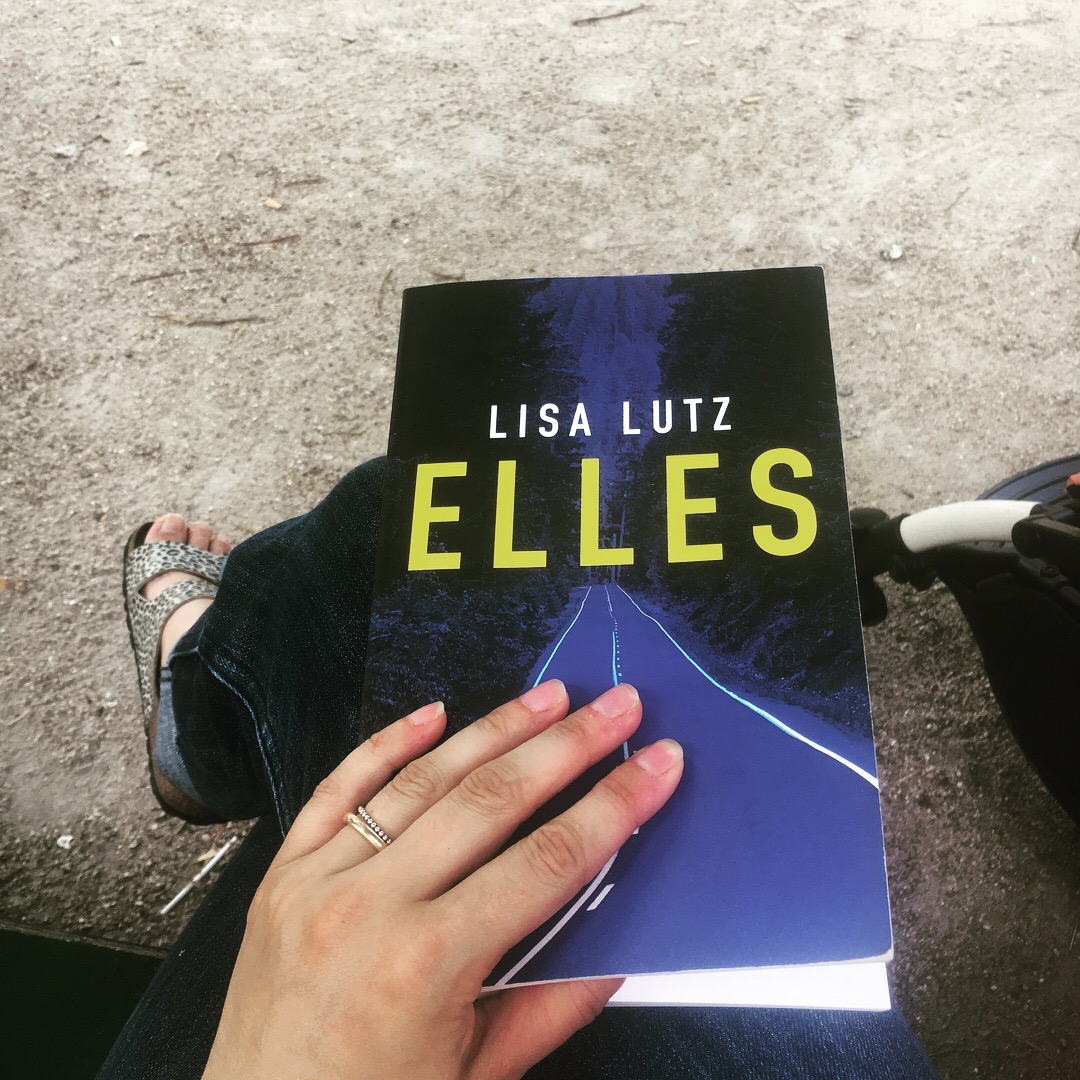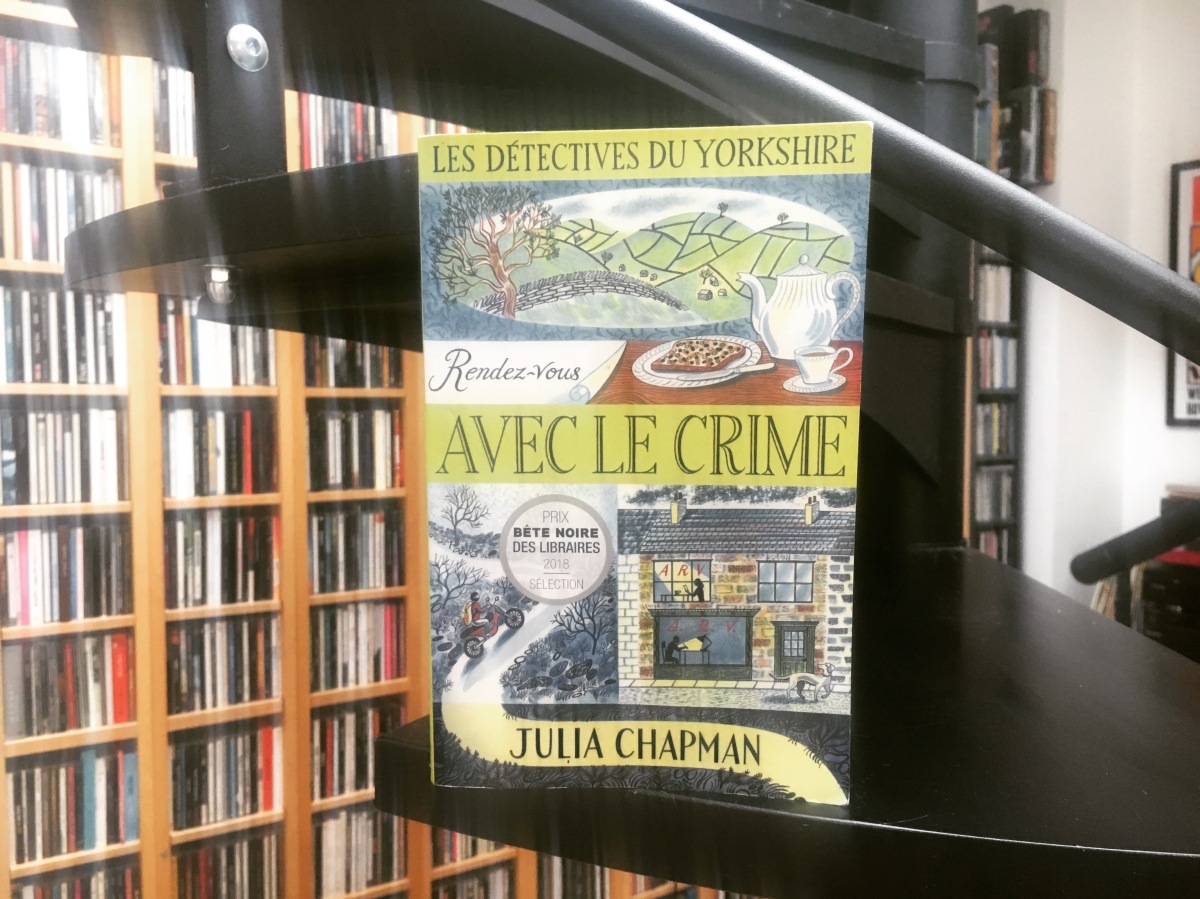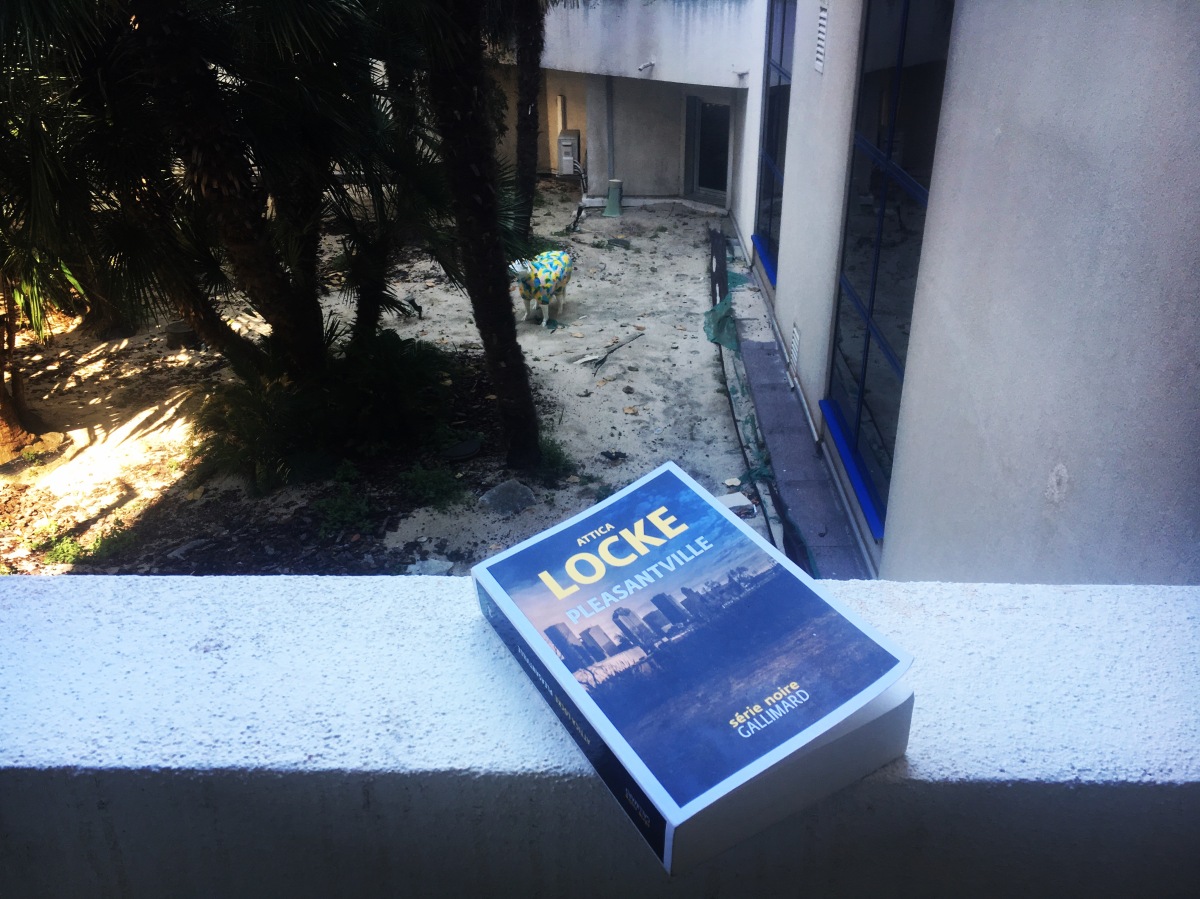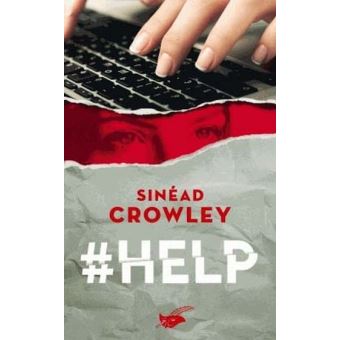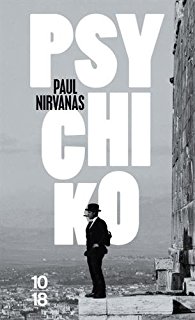Les femmes ont-elles une chance ?
J’avais découvert Megan Abbott avec La Fin de l’innocence (The End of Everything), à l’été 2012. Je crois me souvenir que j’avais acheté le livre en grand format dans une gare (ce dont je ne suis plus très sûre en réalité… peut-être confonds-je avec Rien ne s’oppose à la nuit de Delphine de Vigan que je n’ai jamais réussi à lire). Ce roman m’avait désarçonnée, l’univers m’avait profondément marquée. Megan Abbott parle des jeunes filles comme personne et elle a un talent rare pour créer des ambiances qui persistent bien au-delà de la lecture. À l’époque, je l’avais conseillé à mes amies qui partageaient mes goûts en matière de littérature.
Pour écrire cet article, j’ai fait un tour sur les forums, histoire de voir ce que d’autres lecteurs disaient de ce livre dont je ne me souviens que vaguement (c’est souvent le cas pour les lecture qu’on a aimées) et j’ai été étonnée par le nombre de comparaisons avec Lolita de Nabokov.
J’ai lu Lolita quand j’étais à la fac (il y a peut-être dix ans maintenant), une amie me l’avait offert pour que je lise ce monument de la littérature qu’elle avait adoré. Je me souviens ne pas avoir aimé du tout et d’avoir pensé que s’il avait été écrit par une femme, tout aurait été très différent (ce qui coule sous le sens – J’écris ça et je me dis qu’il est vraiment temps de le relire.) Mais ce qui est sûr, c’est que la comparaison ne m’était jamais venue à l’esprit. Dans mes souvenirs, assez vagues, on était plutôt du côté d’American Beauty.
Mon admiration pour Megan Abbott tient au fait qu’il s’agit d’une femme qui écrit sur des femmes de façon particulièrement pertinente et percutante. Le regard qu’elle pose sur ses personnages est incisif mais également juste. À mon sens, on ne tombe jamais dans la caricature. Et si certains personnages peuvent paraître archétypiques sur le papier (l’adolescente perdue, la chercheuse carriériste…), leur traitement, lui, ne l’est jamais. Megan Abbott fait dans la dentelle. Elle ne met jamais les pieds dans le plat et use toujours de chemins détournés, d’élégance et de subtilité. Elle prend son temps et nous invite à faire pareil. Rien n’est donné au lecteur, tout est offert à une lecture délicate.
Avant d’en arriver à ses deux derniers romans – Avant que tout se brise (You Will know me) et Prends ma main (Give me your hand) que j’ai tous les deux adorés – il faut faire un (très) court détour par le roman noir qu’elle a fait sien pendant un temps. Red Room Lounge (Die a Little), Absente (The Song is You), Adieu Gloria (Queenpin)… autant de titres qui ont fait d’elle une professionnelle du genre, tout tournant toujours autour de figures de femmes plus ou moins fatales dans l’Amérique hollywoodienne des années 50.
Avant que tout se brise parlait d’une adolescente promise à la gloire dans le monde de la gymnastique. Un homme était tué, la jeune fille se blessait, l’univers s’écroulait et les parents tentaient d’en maintenir les fondations coûte que coûte pour que leur fille réalise leurs rêves.
Avec Prends ma main, on attaque un nouveau versant de l’ambition. Les héroïnes sont moins jeunes mais toujours aussi juvéniles, les parents sont morts et on quitte la salle de sport pour le laboratoire. Dans ce nouveau cadre, on retrouve la structure du trio, entièrement féminin et particulièrement anxiogène.
Kit, l’éternelle seconde, touche enfin son rêve du doigt : la titularisation, quand l’éternelle première, son amie de jeunesse, Diane (déesse de la chasse, mais aussi – on l’oublie – de la chasteté et de la virginité), réapparaît dans son labo, aux côtés de son idole et patronne, le Dr Severin. Elle rejoint l’équipe de Kit alors que les places sont chères. Kit est travailleuse, bonne élève, mais rien à voir avec Diane qui penche davantage du côté du génie : une fille extrêmement brillante mais torturée. Et le sujet de recherches de nos trois femmes (les personnages masculins du roman occupent des rôles très secondaires : ils jouent le rôle de révélateurs, catalyseurs) apporte lui aussi sa pierre à l’édifice : le Trouble Dysphorique Prémenstruel (TDP) pousserait des femmes tout à fait « normales » à commettre des actes violents et incontrôlables. Le Dr Séverin, si elle arrive à prouver que cette pathologie existe, révolutionnerait la théorie criminelle en prouvant qu’un certain nombre de femmes accusées de meurtre (par exemple) n’étaient pas conscientes, pas responsables de leurs actes. L’objectif de ces recherches qui passionnent nos trois femmes est donc de faire reconnaitre ce trouble, mais aussi, peut-être de trouver un moyen de le soigner afin d’améliorer la vie de leurs consœurs et de leur éviter de devenir des criminelles malgré elles. La position de Diane, cependant, est floue. Elle n’est pas là pour les mêmes raisons que les autres.
On est ici dans un univers que l’on a plutôt tendance à qualifier de masculin (la recherche médicale, tout comme le sport dans Avant que tout se brise) donc les femmes ne tiendront pas longtemps. Il y a cette fatalité partout, chez Megan Abbott. Et si j’ai trouvé ce roman particulièrement brillant et abouti, c’est parce que l’on sent que sa réflexion sur la question se fait de plus en plus globale : tout, dans cette fiction, fait sens et renvoie au noyau principal : les femmes peuvent-elles y arriver dans l’état actuel des choses ? Ont-elles au moins une chance ? Chez Megan Abbott, rien n’est moins sûr.